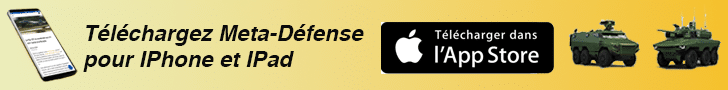اخبار مترجمة :quand les armées ne voulaient pas des 3 stars des exportations françaises
Si la France exporte une grande variété d’équipements, allant du missile antichar au sous-marin, en passant par l’obus d’artillerie et l’avion de chasse, trois équipements se démarquent et portent, en grande partie, la progression des exportations françaises de défense aujourd’hui.
Ainsi, le chasseur Rafale, le sous-marin Scorpene et le canon Caesar, font régulièrement les gros titres, en France comme ailleurs, pour leurs succès internationaux. Si, désormais, tous se félicitent de ces succès, qu’on attribue volontiers à l’innovation et la détermination française, peu savent, en revanche, que ces trois équipements ont eu des débuts pour le moins difficiles, lorsque les armées françaises n’en voulaient pas.
Les stars de l’exportation des équipements de défense français
Il est, aujourd’hui, incontestable que le Rafale, le Scorpene et le Caesar, portent, à eux trois, la dynamique d’exportation française en matière d’armement, grâce à des contrats qui se chiffrent en centaines de millions, voire en milliards d’euros, mais également en entrainant, avec eux, d’importants contrats d’équipements et de maintenance, ruisselant dans toute la BITD (Base Industrielle et Technologie Défense).


Ainsi, après une quinzaine d’années de vaches maigres et d’inquiétudes industrielles et politiques, le Rafale de Dassault Aviation, s’est imposé, avec 300 appareils commandés sur la scène internationale, comme le plus grand succès européen d’exportation d’avions de combat depuis le Mirage F1, dans les années 70 et 80, et comme l’avion de chasse moderne le plus exporté aujourd’hui, après le F-35 américain.
De même, le sous-marin Scorpene, avec 16 navires commandés (bientôt 19 avec la commande indienne) par 5 forces navales, dépasse déjà le précédent record français détenu par la Daphnée dans les années 60, et vient directement menacer le Type 214 allemand, successeur du Type 209 qui détient le record occidental de sous-marins exportés dans les années 80 et 90.
Le canon Caesar, enfin, est devenu le plus grand succès à l’exportation de KNDS France (Ex-Nexter Ex-GIAT), et le système d’artillerie moderne européen le plus exporté ces trente dernières années, ne cédant, à l’échelle de la planète, qu’au K9 Thunder sud-coréen.
Chose encore plus rare, pour un équipement français, le Caesar est en passe de s’imposer comme un équipement standard au sein de l’OTAN, alors que cinq forces armées européennes, en plus de la France, ont déjà signé des commandes en ce sens (Belgique, Estonie, Lituanie, République tchèque et France), et que deux autres ont signé des lettres d’intention en ce sens (Croatie et Slovénie).
Il est toutefois particulièrement intéressant de constater que ces trois équipements qui, aujourd’hui, portent les exportations françaises en matière d’équipements de défense, et qui rapportent plusieurs milliards d’euros de production industrielle export, chaque année, à la balance commerciale nationale, ont connu des débuts particulièrement difficiles.
En effet, les armées françaises, ou certaines d’entre elles, n’en voulaient pas !
La Marine nationale préférait le F/A-18 Hornet au Rafale M en 1993
Lorsqu’il est question des débuts difficiles du Rafale, et de ses différents échecs commerciaux de 1997 à 2015, au Maroc, au Brésil ou encore aux Pays-Bas, il est fréquent de se voir rappeler la phrase désormais ô combien « pas prophétique » du ministre de la Défense Hervé Morin en 2010, lorsqu’il jugeait l’appareil trop compliqué et trop cher pour pouvoir être exporté.


Cette position ministérielle avait, il est vrai, à ce point inquiété Dassault Aviation, que l’industriel préféra sacrifier la ligne d’assemblage du Mirage 2000, après l’échec de l’appareil en Pologne, même si certains marchés potentiels se profilaient déjà en Europe de l’Est et en Asie, à moyen terme, pour le monomoteur français.
En effet, l’avionneur français craignait que le gouvernement français, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, abandonne le Rafale pour une version modernisée du Mirage 2000, comme pouvait l’être le Mirage 2000-9 vendu aux Émirats arabes unis.
Le fait est, en procédant ainsi, Dassault obligea le ministère de la Défense à respecter ses engagements de commandes minimum de Rafale, avec 11 appareils par an, pour maintenir la ligne de production active, jusqu’à la première commande Égyptienne, en 2015, suivie, depuis, par beaucoup d’autres.
Quelques années plus tôt, cependant, c’est bien le ministère de la Défense, et son locataire, François Léotard, qui sauvèrent le programme Rafale, plus spécifiquement, le Rafale Marine. En effet, en 1993, l’ensemble de l’état-major, rue Royale, n’avait qu’une idée en tête : sortir du programme Rafale, pour pouvoir acheter des F/A-18 Hornet américains.
Il est vrai qu’à ce moment-là, l’aéronavale française était face à une évolution très incertaine, en particulier à court terme. Ainsi, les deux porte-avions français, embarquaient toujours des chasseurs de troisième génération, le Super-Étendard d’attaque, le F-8 Crusader de supériorité aérienne, et l’Étendard-4P de reconnaissance.


Ces appareils, mis en œuvre en Irak trois ans plus tôt, étaient alors largement dépassés face à une défense aérienne ou une chasse moderne, et face au groupe aérien embarqué américain, alignant F-14, F-18, A-6 et A-7.
De fait, lorsque l’US Navy proposa à la Marine nationale, une flotte d’une soixantaine de F/A-18 Hornet en occasion récente, pour le prix de moins de vingt Rafale M, tout l’état-major, ou presque, s’est mobilisé pour tenter de faire pression sur le ministère, et laisser le programme Rafale à la seule Armée de l’Air.
Or, le retrait de la Marine de ce programme aurait non seulement fait porter son développement sur la seule Armée de l’air, mais cela aurait, également, augmenté le prix unitaire de l’appareil, avec, à la clé, une réduction du volume de production. De fait, avec le retrait de la Marine, le programme Rafale pouvait, tout simplement, péricliter.
Le ministère de la Défense décida cependant de rejeter l’offre américaine, et de poursuivre le programme Rafale comme prévu. Notons qu’aujourd’hui, les Rafale M du premier lot, au standard F1, ont été portés au standard F3R multirôle, et volent toujours, alors que l’US Navy a retiré du service l’ensemble de ses Hornet.
Le Caesar, le système d’artillerie révolutionnaire conçu par GIAT dans le dos de l’Armée de terre
Si la Marine nationale a tenté de se retirer du programme Rafale pour se tourner vers un chasseur américain, l’Armée de terre, elle, a tout simplement ignoré, pendant plusieurs années, le canon Caesar, et n’a consenti à en commander que cinq exemplaires, initialement, pour lancer la carrière internationale du système d’artillerie conçu par GIAT.


Il est vrai que quand le concept du Caesar est apparu dans l’esprit des ingénieurs français, l’Armée de terre percevait encore le reliquat de ses nouveaux canons automoteurs AuF1 GCT, dont elle était particulièrement satisfaite, un temps au moins. En outre, elle venait de lancer l’acquisition du canon tracté TrF1, pour soutenir les éléments projetés.
De fait, le besoin d’un nouveau système, tout innovant fut-il, était loin d’être la priorité de l’état-major de l’Armée de terre. Surtout que le programme Caesar semblait devoir relever des défis impossibles.
En effet, il s’agissait non seulement de franchir le cap des tubes de 52 calibres, ce qui entrainait de nombreuses évolutions, notamment au niveau de la culasse, mais aussi de parvenir à installer ce canon sur un châssis 6×6 susceptible de résister aux contraintes mécaniques du tir.
Le Caesar avait, force est de le reconnaitre, des ambitions particulièrement élevées, devant assurer un tir soutenu de 155 mm, avec une grande précision et une portée de 40 km, tout en pouvant embarquer, en monobloc, à bord d’un avion C130. À vrai dire, pas grand monde, en dehors des ingénieurs de GIAT, ne pensaient alors la chose possible. Pas question, donc, de dépenser des crédits dans ce programme.


Ces derniers avaient, pourtant, déjà résolu le problème, en ajoutant un faux châssis au châssis principal du camion UNIMOG 6×6 sélectionné, car seul à répondre aux exigences françaises alors. Celui-ci permettait d’absorber une grande partie des efforts mécaniques lors du tir, alors qu’avec d’autres innovations, le Caesar passait de concept farfelu, à système d’armes efficace et redoutable.
En dépit de ces avancées, et de la présentation officielle du Caesar lors du salon Eurosatory 1994, l’Armée de terre n’était toujours pas convaincue. Le ministre de la Défense, Alain Richard, consenti toutefois à en acquérir cinq exemplaires, pour lancer la carrière internationale du système.
Ce ne sera qu’une fois les premiers exemplaires livrés et expérimentés, que l’Armée de Terre prit la mesure du potentiel de ce nouveau système, d’abord pour remplacer les TrF1, puis pour devenir la pièce d’artillerie standard de ses régiments, en remplaçant les AuF1.
Même aujourd’hui, la Marine nationale ne veut pas entendre parler du Scorpene, ni d’un quelconque sous-marin à propulsion conventionnelle.
Si le ministère de la Défense est parvenu à sauver le programme Rafale, et à faire adopter le Caesar par l’Armée de Terre, personne, en revanche, n’a réussi à faire changer de point de vue la Marine nationale, sur la question des sous-marins à propulsion conventionnelle.


Depuis qu’elle a reçu son premier sous-marin nucléaire d’attaque, le Rubis, en 1983, celle-ci considère, en effet, qu’il lui serait très inefficace de se doter d’une flotte mixte, alliant SNA et sous-marins d’attaque à propulsion conventionnelle, ou SSK. Pour elle, un SNA peut faire tout ce que fait un SSK, en mieux, et un plus rapide, alors que l’inverse n’est pas vrai.
De fait, même si on venait à proposer à la Royale deux SSK plutôt qu’un SNA, soit sensiblement la même enveloppe budgétaire, celle-ci refuserait sans le moindre doute.
Pourtant, le SNA a un immense défaut : il ne s’exporte pas. Or, la flotte de 6 SNA et de 4 SNLE, ne suffit pas pour garantir la pérennité et l’évolution des compétences sous-marines de Naval Group et de sa chaine de sous-traitance et d’équipements, pourtant indispensables à la dissuasion française.
D’ailleurs, la Grande-Bretagne, second, et seul pays opérant une flotte sous-marine nationale à propulsion nucléaire comparable à celle de la France, avec 7 SNA et 4 SNLE, a dû se tourner vers certaines technologies américaines, pour concentrer ses investissements de R&D pour maintenir sa filière industrielle.


Naval Group, alors DCNS, prit un parti différent, en poursuivant la conception, la fabrication et l’exportation de sous-marins à propulsion conventionnelle, un exemple unique sur la planète. En effet, tous les industriels construisant des SSK dans le monde, peuvent s’appuyer sur une commande nationale pour concevoir et fabriquer leurs premiers exemplaires.
C’est le cas de la Chine avec le Type 39A, la Russie avec les 636.3 et 677, l’Allemagne avec le Type 214 et Type 212/CD, de la Suède avec le A26, l’Espagne avec le S80 plus et de la Corée du Sud avec le KSS-III, tous proposant à l’export des sous-marins en service, dérivés de modèles en service ou bientôt en service, dans leur propre marine.
Naval group, pour sa part, est parvenue à faire du Scorpene, un modèle initialement codéveloppé avec l’Espagne, avant de devenir exclusivement français, un véritable succès international. Celui-ci a d’ailleurs dépassé le record de 15 sous-marins français exportés établi par la Daphnée dans les années 60, et vient désormais flirter avec les ventes de Type 214 de l’allemand TKMS, pourtant champion absolu des exportations de sous-marins depuis les années 70 et 80 avec le Type 209.
Il fallut, cependant, beaucoup de détermination, et une certaine dose de chances, pour convaincre Santiago et la Marine chilienne, ses premiers clients, d’acquérir les deux premiers Scorpene, pour lancer la carrière internationale du modèle, alors que la Marine nationale refusait, et refuse toujours, de s’en équiper.
Le puissant lien entre l’attractivité à l’exportation et la mise en œuvre d’un armement par les armées nationales
Pourtant, un équipement militaire majeur, comme un sous-marin ou un avion de combat, bénéficie grandement d’être mis en œuvre par ses armées d’origine, pour son attractivité internationale.
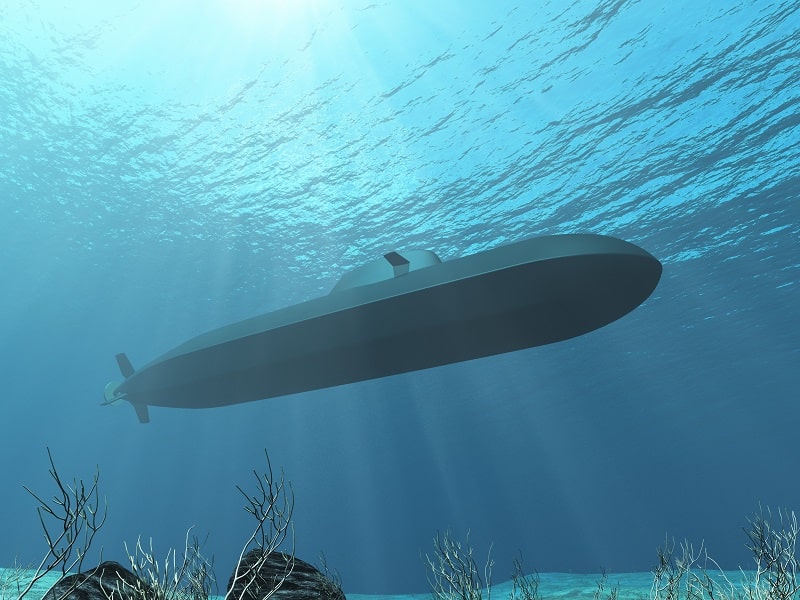
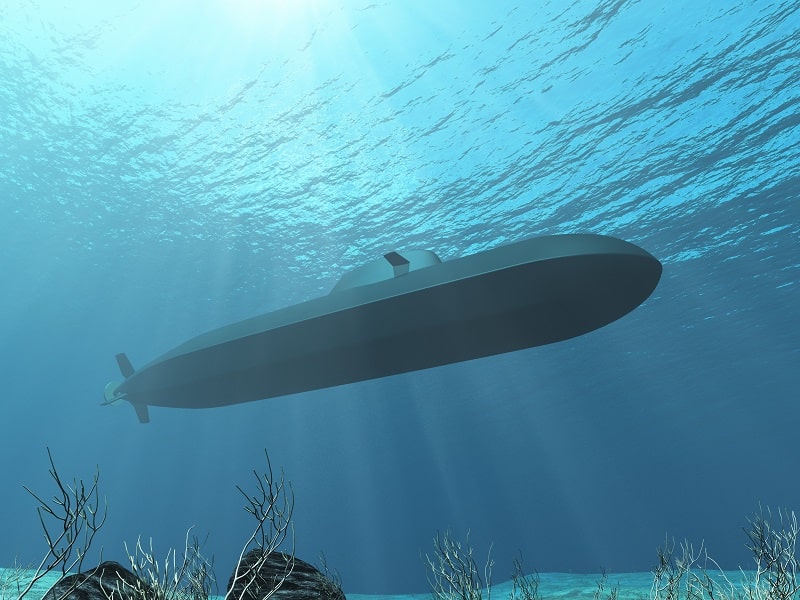
En effet, une commande nationale permet de porter une grande partie de la R&D du modèle, et donc d’en faire un système financièrement compétitif face à la concurrence internationale.
Ainsi, lors de la compétition norvégienne en 2018, Berlin s’assura du succès de TKMS, en annonçant la commande de 2 sous-marins du même modèle pour la Bundesmarine, et en portant 66 % des couts de R&D pour son développement. Ne pouvant s’aligner, Naval Group et le Scorpene, pourtant favoris jusque-là, durent se résigner à abandonner la compétition.
En second lieu, un sous-marin, un avion de combat ou un navire en service dans les armées nationales d’origine, peut prétendre à une meilleure évolutivité, et à une maintenance sécurisée, puisque l’industriel doit, avant tout, assurer ces aspects pour ses propres forces. Ce sont ces paradigmes qui amenèrent la Marine hellénique à exiger des FDI très proches de celles en service au sein de la Marine nationale, pour son programme de frégates.
Enfin, disposer d’un équipement, au sein des armées nationales, permet d’en faire la promotion lors des exercices internationaux, mais aussi lors des conflits. Ainsi, le Rafale et le Caesar sont devenus d’autant plus attractifs qu’ils avaient montré leur efficacité opérationnelle au Levant et en Afrique, obtenant au passage le fameux qualificatif « Combat Proven ».
Peut-on refonder le lien entre les armées et l’industrie de défense au bénéfice des deux ?
Bien évidemment, la commande nationale n’entraine pas le succès international. Toutefois, elle ouvre des opportunités commerciales accrues et renforcées, dans les compétitions et discussions avec les armées partenaires, souvent inaccessibles aux équipements destinés exclusivement à l’exportation.


Cela vaut, d’ailleurs, aussi bien pour les équipements français que pour les autres. Ainsi, le Mig-35 et le JF-31 chinois n’ont toujours pas convaincu sur la scène internationale, alors que le Su-35s, et le J-10C, rencontrent davantage de succès, nonobstant les conditions spécifiques des exportations d’équipements de défens de la Russie et de la Chine.
On peut, dès lors, s’interroger du succès qu’aurait pu rencontrer le Scorpene, ou la corvette Gowind 2500, si la Marine nationale s’était équipée de quelques exemplaires ?
Néanmoins, aujourd’hui, les Armées françaises n’ont aucun intérêt, en dehors de répondre à d’éventuelles exigences du ministère des Armées, pour s’équiper de ces équipements, et, plus largement, pour soutenir l’émergence de nouveaux équipements, n’entrant pas strictement dans son calendrier d’acquisition.
Pourtant, ces exportations représentent un enjeu majeur pour préserver l’autonomie stratégique française, avec une BITD capable de produire la presque totalité des équipements de défense nécessaires, la commande française, seule, ne suffisant pas à cela.
Il conviendrait donc d’imaginer des mécanismes permettant aux armées de retirer des bénéfices directs du succès des exportations françaises, l’amenant à réviser leur stratégie d’équipements pour soutenir l’émergence de ces nouveaux équipements, y compris en participant à leur développement.


Certains pays, comme la Corée du Sud et la Turquie, ont institutionnalisé ce lien, leurs armées commandant, quasiment systématiquement, mais souvent en petites quantités, les équipements produits par leur BITD respective, tant à des fins d’expérimentation opérationnelle, que pour soutenir leurs exportations. Ceci créé, d’ailleurs, un tempo technologique beaucoup plus soutenu pour l’industrie de défense dans ces deux pays.
Une solution, en France, serait de créer un fond ministériel destiné à cette fonction, régénéré par les succès enregistrés à l’exportation de la BITD, par une évaluation et captation des recettes budgétaires ainsi générées. Ce mécanisme budgétaire serait assez proche, dans sa mise œuvre, des recettes variables employées dans les années 2010 pour compléter le financement du ministère de la Défense, par la vente d’infrastructures ou de licences télécom.
Conclusion
On le voit, le succès que rencontre aujourd’hui le Rafale, le Scorpene ou le canon Caesar, doivent bien davantage à la détermination de leurs industriels d’origine, et parfois d’un coup de pouce politique de la part du ministère de la Défense, que du soutien des Armées elles-mêmes.
Il ne s’agit, évidemment, de jeter l’opprobre sur les Armées françaises et leurs état-majors, qui doivent, depuis plusieurs décennies, déployer des trésors d’inventivité pour parvenir à optimiser les programmes industriels indispensables à leur modernisation, avec des budgets sans marge de manœuvre.


Pour résoudre ce problème, et se préparer à absorber le choc que vont représenter l’arrivée des nouvelles BITD chinoises, coréennes ou turques, ainsi que la montée en puissance des offres industrielles allemandes, italiennes ou encore, espagnoles et polonaises, il conviendrait de mettre en œuvre un dispositif dégageant, justement, ces marges de manœuvre, et qui bénéficieraient simultanément aux armées et aux industriels, sans surcouts pour l’état.
Des solutions, en ce sens, peuvent être imaginées, même dans un cadre aussi contraint que celui de la France aujourd’hui. Encore faut-il que le problème soit étudié au bon niveau, par les politiques comme par les industriels eux-mêmes, et bien entendu, par les Armées.
Article du 15 juillet en version intégrale jusqu’au 24 aout 2024
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :meta-defense.fr بتاريخ:2024-08-17 12:06:21
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
تم نشر الخبر مترجم عبر خدمة غوغل